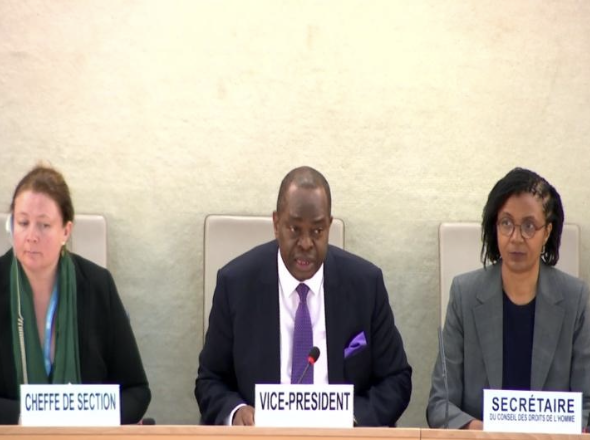HRC58 : Discussion sur la prise d’otages comme torture
Le Dialogue interactif sur le Rapporteur spécial de la torture et d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants
La 58e session du Conseil des droits de l’homme
24 février - 4 avril 2025
Point 3 : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que le droit au développement
4 mars 2025
Traduit par Hind Raad Gathwan / GICJ
Résumé Exécutif
Lors de la 58e session du Conseil des droits de l’homme, le 4 mars 2025, des délégués, des représentants de pays et des organisations non gouvernementales ont participé à un dialogue interactif sur le rapport présenté par Mme Alice Jill Edwards, la Rapporteuse spéciale sur la torture et d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Cette année marque le 40e anniversaire de la création de ce mandat ; cependant, malgré certains progrès, l’éradication de la torture reste encore loin.
La Rapporteuse spéciale a présenté le rapport au Conseil, se concentrant particulièrement sur la prise d’otages et son rôle dans le contexte de la torture. Il a été rappelé que la prise d’otages « implique presque toujours de la torture », soulignant l’importance d’intégrer cette question dans le discours. À cet égard, il n’y a pas eu de remise en question, car pratiquement tous les représentants ont accueilli le rapport et convenu que la prise d’otages et la détention arbitraire sont des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire (DIH). Cependant, la seule source de dissentiment a été exprimée par certains États qui ont souligné la torture subie par les Palestiniens détenus arbitrairement. Ces États ont contesté le rapport et ont critiqué son manque d’approche globale et équilibrée lorsqu’il s’agit de traiter de l’événement du 7 octobre 2023. Un phénomène similaire s’est produit en ce qui concerne l’Ukraine et la Russie.
En essence, tout au long du dialogue, les représentants ont insisté sur la nécessité de prévenir et d’éliminer toutes les formes de torture, y compris la prise d’otages et celles qui se produisent dans les centres de détention.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) condamne fermement la torture et toutes les autres mauvais traitements dégradants, qu’ils soient commis par des acteurs étatiques ou non étatiques, y compris la prise d’otages. Nous soulignons l’importance de renforcer un système juridique international et national non discriminatoire qui mette fin à toute forme de torture et garantisse un examen judiciaire adéquat pour les détenus maltraités de manière injuste. Le CIGJ soutient l’idée que tous les otages, quels qu’ils soient, doivent être libérés sans condition et immédiatement. Enfin, le CIGJ souligne l’exigence que tous les auteurs de torture et ceux qui facilitent la prise d’otages doivent être tenus responsables.
Contexte
Dans la résolution 1985/33 (A/HRC/58/55), la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a décidé de nommer un Rapporteur spécial pour examiner les questions liées à la torture. Au cours des années 1970, de nombreux incidents de prise d’otages par des acteurs non étatiques de haute envergure ont eu lieu. Ainsi, après des négociations, la Convention internationale contre la prise d’otages est entrée en vigueur en 1983 afin de lutter contre l’augmentation des incidents de prises d’otages. La Convention contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants est entrée en vigueur en 1987. Cette obligation internationale a été adoptée pour garantir qu’aucune personne ne devienne victime de torture ou d’autres traitements ou peines dégradants, notamment de la part des autorités gouvernementales.
Quel que soit le contexte, la prise d’otages est un acte répugnant et illégal au niveau international, perpétré tant par des acteurs étatiques que non étatiques. Cette pratique a fait partie intégrante des affaires étrangères pendant des millénaires et continue aujourd’hui en totale défiance du droit international.
Cette infraction peut se produire lors d’une guerre ou être un acte isolé de terrorisme. Les États, les groupes armés et les terroristes utilisent la prise d’otages pour tenter d’obtenir des concessions ou des avantages politiques, financiers ou militaires. Dans les cas où les États contribuent à la prise d’otages, les victimes deviennent des pièces de négociation dans des relations interétatiques tendues. Les perspectives de détention indéfinie sont élevées, car la détention de la victime devient un outil pour influencer les négociations pour sa libération.
La plupart des victimes sont soumises à toutes sortes de tortures physiques et mentales. Certaines subissent des violences sexuelles, des traitements dégradants, des menaces de mort ou des atteintes psychologiques. Les conditions dans lesquelles les otages sont détenus sont indescriptibles et horribles. Non seulement les victimes sont affectées, mais leurs familles le sont également. Elles sont confrontées à la souffrance, à l’incertitude et sont impuissantes face à la disparition forcée de leur proche.
C’est pourquoi il est impératif d’aborder et d’inclure la prise d’otages dans le cadre de la torture. Les objectifs sont de raviver l’engagement de la communauté internationale sur ce sujet, de renforcer les lois et les conventions, ainsi que de reconnaître les lacunes dans les législations internationales et nationales.
Résumé du Rapport de la Rapporteuse Spéciale
Alice Jill Edwards, la Rapporteuse spéciale sur la torture, a soumis son rapport dans le cadre de la résolution 58/55 du Conseil des droits de l’homme. Ce rapport fournit une évaluation de la manifestation de la prise d’otages, du point de vue de l’interdiction absolue de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Au cours de la recherche pour ce rapport, il a été révélé que l’ampleur du phénomène est en réalité plus grande et que sa répartition géographique est plus large que ce que les statistiques laissent indiquer. Son rapport documente des cas en Chine, en Iran, en Birmanie, en Corée du Nord, en Russie, aux Émirats arabes unis et au Venezuela.
Il est important de souligner une distinction clé faite par le rapport. Selon ce dernier, l’élément principal qui différencie la prise d’otages des autres formes d’enlèvements est l’intention des auteurs de l’acte d’obtenir une concession ou un avantage, qu’il soit financier, politique ou militaire.
De plus, le rapport précise qu’il n’est pas nécessaire que les individus soient détenus de manière illégale ou arbitraire pour être considérés comme des otages. Inversement, des personnes légalement détenues, comme celles représentant une menace pour la sécurité, peuvent par la suite être utilisées comme otages pour faire pression sur un tiers.
La Montée du Jihadisme
Le développement du terrorisme jihadiste dans les années 2000 a conduit à la cible de nombreuses écoles, femmes, travailleurs humanitaires et journalistes. En 2014, Boko Haram a enlevé 276 filles d’école dans le nord-est du Nigéria. Par la suite, certaines ont été proposées en échange de prisonniers. En 2023, il a été révélé que 98 de ces filles étaient toujours en captivité. Un autre exemple est celui de Joe Woodke, un travailleur humanitaire, qui a été kidnappé par des terroristes au Niger en 2016. Il a été retenu en otage dans le nord du Mali pendant plus de six ans dans le cadre d’échanges.
Victimes lors des opérations de sauvetage
De nombreuses prises d’otages par des acteurs non étatiques ont entraîné des pertes massives, souvent lors des opérations de sauvetage. En 2002, lors de l’opération de sauvetage du siège du théâtre de Moscou par des militants tchétchènes, environ 128 otages sont morts à cause du gaz toxique utilisé lors de l’opération. En 2013, une branche d’Al-Qaïda a pris pour cible la station gazière d’Amenas en Algérie, capturant 800 otages. Après l’attaque de l’armée algérienne, environ 40 otages ont perdu la vie.
La Prise d’Otages par les États
Le phénomène de la prise d’otages par des États a augmenté au cours de la dernière décennie. Certains États détiennent des ressortissants étrangers sur la base d’accusations fabriquées ou exagérées dans le but d’extraire des aveux, de servir des objectifs de politique étrangère et d’autres buts. En manipulant les systèmes judiciaires et en exploitant les mécanismes procéduraux, ces États retardent la libération des détenus tout en niant simultanément leur statut d’otages ou de détenus injustement emprisonnés.
Depuis 2010, au moins 66 cas de prise d’otages par l’État ont été documentés en République islamique d’Iran. La prise d’otages par des États pendant un conflit armé se produit également, comme en témoigne la guerre de la Fédération de Russie en Ukraine. Selon les informations, plus de 15 000 civils ukrainiens sont détenus pour exercer une pression politique et psychologique sur l’Ukraine et intimider la population.
Les Conditions et les Souffrances Endurées
La position du rapport est sans équivoque : la prise d’otages est presque toujours une forme de torture, car les tourments physiques et psychologiques sont graves et durables. L’enlèvement est souvent accompagné de violence. Les otages vivent dans une peur constante de la violence et de la mort. Les victimes subissent des passages à tabac, de la torture (psychologique et physique), des exécutions simulées, des aveuglements prolongés, de la faim, des isolements solitaires prolongés, la négligence des soins médicaux, des tentatives de suicide et des agressions sexuelles. Ce sont des caractéristiques courantes documentées dans le rapport.
Les témoignages horribles mentionnés dans le rapport décrivent des conditions effroyables, allant des « trous de l’enfer » dans les jungles, les tunnels, les prisons, les sous-sols et plus encore. Pour la réalisation de ce rapport, plus de 20 anciens otages et membres de familles ont été interviewés. Beaucoup ont témoigné de « conditions de prison putrides et d’isolement désespéré ».
L’Impact sur les Familles et les Luttes Post-Libération
Les familles sont également des victimes en raison de leur expérience traumatique. Elles vivent dans le doute et une profonde angoisse, attendant une preuve de vie et la libération, essayant d’éviter la ruine financière, et certaines sont réduites au silence par leurs gouvernements. Selon le rapport, de nombreux survivants et leurs familles ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas soutenus par leurs gouvernements pendant leur détention et après leur libération. Les gouvernements ont exprimé à la Rapporteuse spéciale qu’ils étaient mal préparés et manquaient d’expertise pour aider les survivants. Les enfants des otages sont laissés dans la confusion, ils souffrent d’insomnie, d’anxiété de détachement et de retrait.
Le rapport souligne que l’épreuve de l’otage n’est pas terminée pour les survivants eux-mêmes. S’ils ont la chance d’être libérés, beaucoup souffrent de troubles de stress post-traumatique (TSPT), d’anxiété chronique et de problèmes de santé graves qui nécessitent des décennies de réhabilitation. De plus, les détenus de longue durée se retrouvent privés de leur emploi ou avec des compétences professionnelles obsolètes. En conséquence, ils font face à des dettes et à l’impossibilité de retrouver la vie qu’ils menaient avant leur enlèvement.
Interdiction Absolue de la Prise d’Otages
Il y a 176 États membres de l’ONU signataires de la Convention internationale de 1979 contre la prise d’otages, mais la convention relative aux otages est rarement mentionnée. La Convention exige des parties qu’elles adoptent des lois pour criminaliser, enquêter, poursuivre ou extrader, et prennent des mesures pour gérer la situation des otages, tout en contribuant à la prévention de la prise d’otages.
Cependant, la Convention ne s’applique pas à la prise d’otages en temps de conflit armé et ne s’applique pas si l’acte se déroule à l’intérieur d’un seul État. Pour qu’un événement entre dans le champ d’application de la Convention, il doit y avoir un élément transnational dans l’infraction. Malgré quelques divergences, la Rapporteuse spéciale adopte la position selon laquelle la Convention s’applique à la prise d’otages par l’État.
Depuis les procès de Nuremberg, la prise d’otages est interdite en vertu du droit international humanitaire (DIH) et totalement proscrite par les Conventions de Genève. Cette interdiction, selon les Protocoles additionnels, est considérée comme faisant partie du droit international coutumier. L’article 75 (2)(c) du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 affirme que la prise d’otages est absolument interdite « à tout moment et en tout lieu, qu’elle soit commise par des agents civils ou militaires ». De plus, les grands organes internationaux - de la Cour internationale de Justice (CIJ) au Conseil de sécurité de l’ONU - ont continuellement et sans équivoque condamné tous les actes de prise d’otages.
La prise d’otages n’est pas explicitement mentionnée comme un crime contre l’humanité dans le Statut de Rome ou dans le droit international. Néanmoins, ses dommages et conséquences inhérents, y compris la torture, sont punissables lorsqu’ils font partie d’une attaque généralisée contre une population.
Malgré les interdictions internationales, la prise d’otages reste un « crime à faible risque et à forte récompense ». Pour que cela change, les auteurs doivent être tenus responsables, ce qui souligne l’importance de l’application des cadres internationaux.
Recommandations Clés
Dans le rapport, la Rapporteuse spéciale a adressé des demandes aux États et aux organes de l’ONU. Ses principales recommandations étaient les suivantes :
- que la Cour pénale internationale (CPI) intensifie ses enquêtes sur la prise d’otages ;
- que les États poursuivent et traduisent en justice les auteurs de prises d’otages ;
- que des sanctions ciblées, comme les sanctions Magnitsky (sanctions visant les responsables de violations des droits de l’homme), soient déployées de manière plus rigoureuse contre les auteurs ;
- qu’il soit demandé la nomination d’un Représentant spécial du Secrétaire général (RSG) sur la prise d’otages ;
- que des actions multilatérales et des mécanismes d’alerte précoce soient mis en place pour la prévention et la surveillance ;
- que les États nomment des responsables seniors des liaisons avec les otages pour tenir les familles informées et impliquées ;
- que les États fournissent une réparation complète et un soutien global aux survivants et à leurs familles ;
- que les États reconnaissent le statut des enfants en tant que victimes et offrent une restitution adaptée aux enfants et axée sur leurs besoins.
Dialogue Interactif
Déclarations d’Ouverture
La Rapporteuse spéciale, Mme Alice Jill Edwards, a ouvert le dialogue en évoquant sa visite au Chili. Elle a salué les progrès constants dans les domaines de la justice transnationale, de la construction des institutions et des droits de l’homme. Plus important encore, elle a proposé trois principales recommandations.
Elle a tout d’abord reconnu les efforts de l’État pour tenir responsables ceux qui ont commis des violations des droits de l’homme durant l’ère Pinochet. Cependant, de nombreuses victimes demeurent disparues, des affaires sont toujours en suspens et les présumés coupables n’ont pas encore été traduits en justice. Par conséquent, elle a appelé le gouvernement à accélérer le jugement de ces affaires historiques.
Ensuite, Mme Edwards a abordé la question des troubles sociaux et de la réponse sévère de l’État aux manifestations publiques, qui constituent des violations des droits de l’homme, comme l’Estallido Social en 2019. Elle a entendu des témoignages de personnes blessées, dont certains ont perdu la vue de façon permanente. Elle a salué la façon dont la police chilienne utilise des armes à projectiles en caoutchouc à trois projectiles, contrairement aux douze projectiles utilisés lors des troubles de 2019. Cependant, elle a insisté sur le fait que les munitions contenant plusieurs projectiles devraient être retirées du service en raison de leur imprécision, ce qui représente un risque considérable pour les passants. Elle a suggéré que seules des armes à tir unique et non létales soient considérées comme acceptables.
Enfin, elle a identifié la surpopulation carcérale et le manque d’opportunités de réhabilitation comme les principaux défis lorsqu’il s’agit d’évaluer les normes de traitement dans les différents lieux où des personnes sont privées de liberté. Les établissements visités étaient principalement vétustes, nécessitant des rénovations ou des remplacements. Dans certaines infrastructures, l’espace disponible par personne était bien inférieur aux normes internationales, constituant ainsi un traitement inhumain.
Position des Pays
Le représentant du Chili, M. Francisco Carvajal, a ensuite pris la parole. Il a réaffirmé les efforts déployés par le Chili pour lutter contre la torture après la fin de la dictature. Il a également confirmé comment le pays a mis en place de nombreuses réformes en ce qui concerne les forces de police et a adopté des mesures de réparation. Dans le contexte de la privation de liberté, M. Carvajal a exprimé son accord avec les recommandations de la Rapporteuse spéciale, précisant qu’une attention significative sera portée à cette question. Il a abordé le constat du rapport selon lequel la surpopulation carcérale est un problème auquel le pays est confronté. Il a attribué cela aux nouvelles réformes juridiques et à l’augmentation de la criminalité, qui ont entraîné une hausse de la population carcérale.
La déléguée de l’Union européenne, Mme Iva Gavrilova, a souligné que le commerce sans torture était une étape cruciale pour l’élimination de la torture. En outre, les États devraient envisager d’interdire le commerce mondial de biens utilisés à cet effet. Elle a exprimé des préoccupations concernant la montée de la détention arbitraire dans les relations entre États.
La représentante de l’Ukraine, Mme Yevheniia Filipenko, a insisté sur la nécessité d’une réponse mondiale forte face à la torture. Elle a abordé la manière dont l’invasion de quatre ans, menée par la Russie, a été marquée par l’utilisation généralisée de la torture contre les civils et les prisonniers de guerre. Elle a fermement affirmé que la politique coordonnée de la Russie constitue des crimes contre l’humanité. Mme Filipenko a réitéré que 15 000 otages ukrainiens sont utilisés comme moyen de pression pour instiller la peur parmi la population ukrainienne. Elle a ajouté que ces otages sont pour la plupart détenus en isolement total. Enfin, elle a appelé la communauté internationale à adopter une position ferme et à persuader la Russie de mettre fin à l’utilisation systématique de la torture et de libérer les otages en toute sécurité.
M. Muneeb Ahmed, représentant du Pakistan, a pris la parole au nom de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Il s’agissait de la première délégation à exprimer son désaccord avec le rapport de la Rapporteuse spéciale. M. Ahmed a indiqué que l’OCI aurait apprécié une approche plus globale lorsqu’il s’agissait d’aborder la question de la Palestine. Ils ont notamment exprimé leur déception face au fait que le rapport ait évité de traiter de la situation des otages palestiniens, dont beaucoup sont emprisonnés dans des conditions de torture depuis des années. En ce qui concerne les événements du 7 octobre 2023, il a souligné que depuis huit décennies, les Palestiniens et leurs droits inaliénables ont été pris en otage par un régime d’occupation illégal. M. Ahmed a conclu sa déclaration en insistant sur le fait que les procédures spéciales doivent être maintenues selon les normes les plus élevées d’impartialité et de bonne foi.
La représentante de l’État de Palestine, Mme Rana Arrabi, a réaffirmé que le rapport ne fournissait pas une vue d’ensemble impartiale de la torture. Elle a souligné qu’au cours des décennies, la population palestinienne a enduré le régime d’occupation israélien, qui utilise la détention arbitraire de masse comme un outil de coercition. Elle a proclamé que ces victimes font face à des abus systématiques et généralisés et sont utilisées pour faire pression sur les civils afin de les soumettre. Elle a également évoqué qu’à partir du 7 octobre, dans le cadre d’une campagne génocidaire, des milliers de Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, y compris des personnes âgées, des enfants, des femmes enceintes, des malades graves et du personnel médical, ont été détenus arbitrairement et transférés en Israël, en violation flagrante du droit international. Les noms et les lieux de détention sont inconnus, l’accès aux avocats leur est refusé, et dans certains cas, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a été interdit de leur rendre visite.
La représentante de la Zambie, Mme Eunice M. Tembo Luambi, a souligné l’importance de la réhabilitation et de la réparation pour les victimes de torture. Elle a intéressamment encouragé la Rapporteuse spéciale à explorer les lacunes existantes dans le cadre juridique international contre la prise d’otages, notamment les formes évolutives de cette pratique. Cela permettrait d’intégrer la prise d’otages en tant qu’infraction explicite dans l’élaboration des articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité.
La représentante de l’Indonésie, Mme Ainan Nuran, a également convenu que le rapport manquait d’équilibre dans son évaluation. Elle a reconnu que le rapport condamne à juste titre la prise d’otages par des acteurs non étatiques ; cependant, il ne parvient pas à traiter correctement la détention systématique et arbitraire sans procédure régulière, en particulier par Israël dans les territoires palestiniens occupés (OPT). Elle a réitéré que des milliers de Palestiniens – y compris des enfants, des journalistes et des personnalités politiques – restent détenus indéfiniment sans inculpation formelle, ce qui constitue des violations graves du droit international humanitaire (DIH) et du droit international des droits de l’homme. Par conséquent, elle a également exhorté la Rapporteuse spéciale à adopter une approche plus impartiale et globale pour traiter de la détention illégale et de toutes les formes de prise d’otages afin de garantir une responsabilité universelle.
Mme Elhameh Paydar, représentante de la République islamique d’Iran, a commencé en exprimant leur totale consternation face au fait que le sujet n’ait pas été correctement traité. Elle a ouvertement déclaré que les commentaires communiqués à la Rapporteuse spéciale n’avaient pas été pris en compte en ce qui concerne les paragraphes 24 et 29 (faisant référence à des cas spécifiques de la participation de l’Iran à la prise d’otages). Elle a affirmé que le rapport ne tenait pas compte du contexte historique lorsqu’il abordait les événements qui se sont déroulés il y a 50 ans. Par conséquent, elle a rejeté le contenu du paragraphe 29, car elle estimait que les affirmations formulées étaient erronées et politisées. Elle a conclu en déclarant qu’il était « choquant » que la Rapporteuse spéciale ait omis de mentionner les otages iraniens aux États-Unis ou ceux qui sont sur le point d’être extradés.
Le représentant de la République populaire démocratique de Corée, M. Ho Tong Hyok, a totalement rejeté le rapport et les allégations de la Rapporteuse spéciale, affirmant que celle-ci avait énoncé des données non fondées et sans preuves concernant la Corée du Nord. Il a proclamé que la Rapporteuse spéciale avait tenté de saper le système social de la Corée du Nord en suggérant la présence de prises d’otages. Il a attiré fortement l’attention sur le fait que le rapport mentionnait des pays en développement mais omettait de citer la prise d’otages pratiquée par les États-Unis et d’autres pays occidentaux. Il a conclu en soulignant que cela contribuait à la reconnaissance mondiale que les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU sont politisés, ce qui constitue une grande violation du principe d’universalité, d’objectivité, de non-sélectivité et de non-politisation.
Le représentant de la Fédération de Russie, M. Artem Isakov, a exprimé son désaccord avec l’approche biaisée dans la section du rapport concernant la Russie. Il a souligné que la Russie condamne l’utilisation de la torture et garantit à ses citoyens le droit d’être protégés contre la torture, conformément à la Constitution russe. Il a également demandé à la Rapporteuse spéciale de s’abstenir d’adopter une approche politisée et à double standard.
M. Jiang Han, le représentant de la Chine, a catégoriquement rejeté les accusations d’arrestation arbitraire de ressortissants étrangers en Chine dans le rapport, affirmant que le pays respecte la Convention et engage des discussions avec le Comité contre la torture. Il a affirmé que la législation chinoise interdit explicitement l’obtention de confessions par la torture et tout mauvais traitement des détenus, tout en prévoyant des recours en cas de violation de la loi. Il a mis en lumière comment certains pays ont des problèmes de discrimination raciale, où des pratiques arbitraires dans les prisons et des mauvais traitements sont ciblés contre les migrants.
M. Mohibullah Taib, le représentant de l’Afghanistan, a abordé l’utilisation systématique de la torture toujours en cours sous le régime des talibans. Il a révélé la brutalité des abus physiques et psychologiques infligés aux détenus. Cela inclut des flagellations publiques, des suspensions prolongées, des techniques de suffocation, des exécutions simulées et d’autres pratiques dégradantes qui demeurent des mécanismes enracinés et exécutés en toute impunité. Il a souligné que ce n’était pas un incident isolé, mais un modèle délibéré.
La représentante de la République bolivarienne du Venezuela, Mme Marisela Del Valle Rojas Garmendia, a rejeté les allégations infondées dans le rapport qui font état de détentions arbitraires de ressortissants étrangers dans le but de les utiliser pour obtenir des gains financiers, sans preuves à l’appui. Elle a également insisté sur le respect du code de conduite, précisant que les fonctions exercées doivent être fondées sur des faits objectifs et crédibles.
Les déclarations de M. Muhammadou M.O. Kah, le délégué de la Gambie, ont suggéré que la Gambie fait partie des pays ayant enregistré des progrès dans le domaine de la torture. Le pays a mis en place des réformes significatives pour renforcer les cadres juridiques et institutionnels visant à prévenir la torture. Il a annoncé que la création de la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que l’adoption de la Loi sur l’interdiction de la torture en 2023, représentent des étapes cruciales dans la bonne direction.
Organisations Non-Gouvernementales
Après les représentants des États, les délégués des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) ont pris la parole devant le Conseil. De nombreuses ONG ont exprimé leur préoccupation concernant les otages palestiniens, en particulier les femmes et les enfants qui sont détenus de manière arbitraire. Elles ont donc exprimé leur mécontentement concernant le rapport qui, selon elles, ne souligne pas suffisamment la torture abominable subie par les Palestiniens, certains insinuant même que le silence facilite l’impunité. D’un autre côté, quelques ONG ont salué le rapport pour avoir évoqué les otages israéliens enlevés le 7 octobre.
Toutes les ONG ont souligné l’importance pour les États de respecter leurs obligations internationales en vertu des deux Conventions concernant la torture et la prise d’otages. Elles ont plaidé en faveur des droits des individus enlevés et de ceux détenus sur des accusations infondées. Elles ont également insisté sur le fait que l’impunité ne peut pas être la règle pour cette question et que les responsables doivent être identifiés et poursuivis par le système judiciaire.
Remarques de Clôture
Pour les remarques finales du dialogue interactif, la Rapporteuse spéciale a réaffirmé que la prise d’otages n’est pas une tactique appropriée pour régler des griefs ou mener des relations internationales. Elle a exprimé sa confiance dans le fait que le rapport est du côté de l’histoire et ses espoirs qu’il ravivera un débat intéressant sur ce sujet, qui a été regrettablement négligé depuis trop longtemps. Elle a rendu hommage aux victimes et a partagé son espoir que le rapport ait servi à faire en sorte que les victimes sachent qu’elles ne peuvent pas être oubliées.
Enfin, elle a présenté ses deux principales recommandations. Elle a d’abord encouragé les États confrontés à des problèmes d’enlèvements nationaux à nommer un responsable de haut niveau pour aider les familles à recevoir des mises à jour constantes et à participer aux négociations. Elle a ensuite appelé le Secrétaire général à établir un SRSG sur la prise d’otages, soulignant qu’à son avis, “sans cela, nous serons de retour ici dans quelques années.”
Position de Geneva International Centre for Justice (GICJ)
Geneva International Centre for Justice (GICJ) appelle à ce que toutes les victimes et survivants de prises d’otages obtiennent justice. Ils doivent être compensés et réhabilités avec une aide financière, médicale et psychologique à long terme. Le CIGJ soutient également l’appel de la Rapporteuse spéciale pour que l’ONU crée une entité responsable, comme le SRSG, pour défendre davantage les intérêts des victimes de la prise d’otages. Le CIGJ condamne ceux qui utilisent des individus comme des pièces de négociation. La prise d’otages est un jeu cruel, et elle ne peut pas être acceptée comme un outil de diplomatie ou de guerre. Le CIGJ appelle toute la communauté internationale à contribuer à l’éradication complète de la prise d’otages. Chaque État doit jouer son rôle pour que cela devienne une réalité.