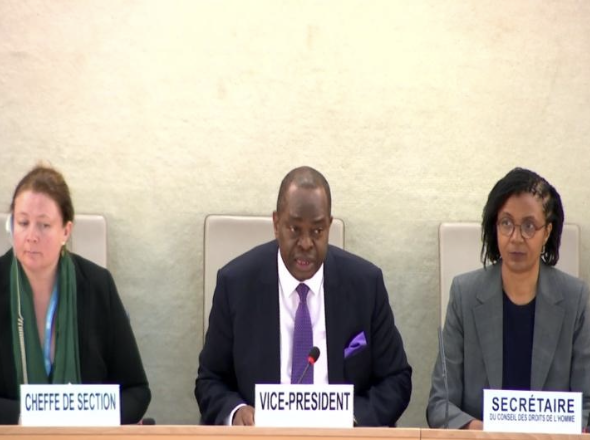HRC58 : Risques liés à la localisation pour les défenseurs des droits de l’homme en milieu rural
58ème session du Conseil des droits de l’homme
24 février – 4 avril 2025
Dialogue interactif avec la Rapporteuse spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme
5 et 6 mars 2025
Traduit par Hind Raad Gathwan / GICJ
Résumé exécutif
Le 5 mars 2025, lors de la 58e session du Conseil des droits de l’homme, la Rapporteuse spéciale, Mary Lawlor, a présenté son rapport sur la situation des défenseurs des droits de l’homme. Cette présentation a été suivie d’un dialogue interactif avec les États membres et les ONG les 5 et 6 mars 2025.
Le rapport a souligné que les défenseurs des droits de l’homme travaillant dans des contextes isolés, reculés ou ruraux sont confrontés à des risques accrus en raison de leur isolement géographique. Ces risques incluent un accès limité aux réseaux de soutien, une vulnérabilité accrue aux représailles de la part des États et des acteurs non étatiques, ainsi que des difficultés à attirer l’attention de la communauté internationale sur leur travail.
Geneva International Centre for Justice (GICJ)soutient pleinement le rapport de la Rapporteuse spéciale, notamment son accent sur l’établissement de mécanismes de protection efficaces et l’amélioration des ressources en matière de sécurité numérique. Le GICJ appelle les États à prendre des mesures proactives pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux des zones isolées et rurales, et à mettre en place des politiques répondant aux besoins spécifiques des groupes marginalisés. De plus, le GICJ exhorte les entreprises à assumer leurs responsabilités et souligne le rôle crucial des organisations de la société civile dans la protection et le soutien des défenseurs des droits de l’homme en milieu rural.
Contexte
Les défenseurs des droits de l’homme sont souvent la cible d’acteurs étatiques et privés en raison de la nature de leur travail. Leur plaidoyer, leurs efforts éducatifs, leurs activités journalistiques et leurs tentatives de pression internationale sont souvent perçus comme une menace. Par conséquent, divers moyens sont utilisés pour les persécuter et saper leur travail, notamment :
- Ignorer leurs recommandations et critiques
- Ridiculisation et diffamation
- Surveillance
- Harcèlement judiciaire
- Détention arbitraire
- Poursuites abusives
- Interdictions professionnelles
- Menaces
- Attaques impunies
- Disparitions forcées
- Assassinats
Le mandat des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme vise à assurer la protection et le soutien des personnes ou groupes qui promeuvent et défendent les droits humains à travers le monde. Ce mandat s’appuie sur la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme (1998), qui affirme le droit des individus à promouvoir et défendre les droits humains, y compris la liberté de réunion pacifique, la liberté d’expression et le droit de demander réparation pour les violations sans crainte de représailles.
Nommée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, la Rapporteuse spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme, actuellement Mary Lawlor, est chargée de surveiller et de rendre compte de la situation des défenseurs des droits de l’homme, de sensibiliser aux violations dont ils sont victimes et de formuler des recommandations pour améliorer leur protection.
Les Nations Unies exhortent en permanence les gouvernements à assurer la responsabilité des violations commises contre les défenseurs des droits de l’homme. Elles leur demandent de prévenir les attaques, détentions et actes de harcèlement de la part d’acteurs non étatiques et d’enquêter sur les violations. Le Conseil des droits de l’homme, la Rapporteuse spéciale et d’autres organes œuvrent pour garantir les droits des défenseurs des droits de l’homme, mettre en place des mécanismes d’assistance et tenir les États responsables des violations, contribuant ainsi à un environnement plus sûr pour ceux qui défendent les droits fondamentaux.
Résumé du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme
Dans son rapport intitulé « Hors de vue : Les défenseurs des droits de l’homme travaillant dans des contextes isolés, reculés et ruraux », Mary Lawlor examine les défis uniques auxquels ces défenseurs sont confrontés. Elle met en évidence la situation particulièrement précaire des défenseurs œuvrant dans des zones rurales ou reculées.
Les défenseurs des droits humains en milieu rural sont souvent ignorés par les autorités, les mécanismes des Nations Unies et les ONG nationales et internationales en raison de leur isolement géographique. Mary Lawlor souligne que leur travail est fréquemment « hors de vue », ce qui les rend plus vulnérables aux menaces et aux abus. Les défenseurs autochtones sont particulièrement touchés, car ils exercent souvent dans ces zones et subissent une discrimination accrue par rapport aux villes, où les valeurs, coutumes et croyances traditionnelles sont moins dominantes.
La Rapporteuse spéciale a mis en évidence plusieurs facteurs aggravants :
- Absence de mécanismes de soutien
- Manque de liaisons de transport
- Faible couverture médiatique
- Présence limitée des forces de l’ordre locales
- Accès restreint à Internet et aux prestataires de services adaptés
Elle a exhorté les États à remplir leurs obligations morales et légales pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, notamment ceux travaillant dans des zones reculées et rurales. Parmi les mesures proposées, elle recommande aux États de :
- Renforcer les réseaux de soutien
- Développer l’accès à Internet
- Instruire leurs ambassades et missions diplomatiques afin qu’elles se rendent sur place pour soutenir les défenseurs en difficulté
- Prendre en compte la diversité des défenseurs travaillant en milieu rural
Le rapport insiste sur la nécessité de mesures de protection renforcées et d’une solidarité internationale pour soutenir ces défenseurs dans leur travail essentiel.
Par ailleurs, Mary Lawlor a appelé les entreprises à adopter des politiques de tolérance zéro face aux représailles contre les défenseurs des droits de l’homme et à garantir que le consentement éclairé soit respecté dans tous les projets pertinents.
Enfin, les organisations de la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme doivent veiller à ce que leurs actions incluent les défenseurs œuvrant dans les zones rurales afin de garantir leur protection et reconnaissance.
Dialogue interactif
Déclarations d’ouverture
Mary Lawlor, la Rapporteuse spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme, a pris la parole pour exposer les défis supplémentaires auxquels font face les défenseurs des droits de l’homme travaillant dans des contextes isolés, reculés et ruraux en raison de la géographie et du manque d’accès aux ressources essentielles. Elle a commencé la présentation de son rapport en soulignant le travail souvent sous-évalué et négligé des défenseurs des droits humains. Elle a débuté son exposé en présentant ses visites dans deux pays : l’Algérie et le Brésil.
Brésil
Le Brésil fait face à d’énormes défis pour les défenseurs des droits humains, y compris les meurtres, les attaques physiques violentes, les menaces et la dépossession de leurs terres. Les défenseurs les plus vulnérables sont ceux engagés dans les luttes pour la terre, les défenseurs des peuples autochtones, les travailleurs ruraux et les défenseurs des autres communautés traditionnelles. Les femmes défenseures des droits humains, en particulier celles confrontées à des violences intersectionnelles, ainsi que les journalistes traitant des droits humains au niveau local, les défenseurs trans dans tous les domaines, et les activistes sociaux et culturels travaillant avec les plus vulnérables de la société brésilienne, sont également particulièrement exposés.
Elle a exhorté le Brésil à garantir que le droit au consentement libre, préalable et éclairé soit respecté dans les activités commerciales, y compris le droit de dire non. Elle a également insisté sur la nécessité d’améliorer le programme de protection des défenseurs des droits humains. Elle a fait appel au Brésil pour qu’il mette en œuvre les suggestions formulées dans le rapport.
Algérie
Concernant l’Algérie, la Rapporteuse spéciale a affirmé que des progrès ont été réalisés pour accroître la participation de la société civile. Cependant, les défenseurs des droits humains qui choisissent de travailler en dehors des voies traditionnelles de la société civile craignent des représailles. Elle a critiqué l’utilisation continue de l’article 87 bis du code pénal pour accuser les défenseurs des droits de l’homme de crimes liés au terrorisme. La définition du terrorisme contenue dans cet article est excessivement large, offrant une vaste portée aux services de sécurité pour arrêter les défenseurs des droits de l’homme.
La Rapporteuse spéciale a appelé le gouvernement algérien à modifier cet article et à garantir que la définition du terrorisme et des crimes associés soit accessible, précisément formulée, non discriminatoire et non rétroactive, conformément aux normes internationales.
La Rapporteuse spéciale a souligné que les défenseurs des droits de l’homme travaillant dans des contextes isolés, reculés et ruraux sont souvent négligés par les autorités, les mécanismes des Nations Unies et les ONG nationales et internationales. Certains gouvernements ont pris des mesures pour protéger ces défenseurs, mais ces mesures sont souvent plus théoriques que pratiques et restent insuffisantes. Elle a illustré cette situation avec le meurtre d’un défenseur des droits de l’homme autochtone de Santa Rosalia dans la région amazonienne du Pérou en novembre 2023. Elle a cité l’ONG Front Line Defenders, qui a rapporté l’assassinat de plus de 300 défenseurs des droits de l’homme dans le monde en 2023, dont beaucoup travaillaient dans des zones rurales, isolées ou reculées.
Les défenseurs autochtones travaillant dans ces zones signalent fréquemment à la Rapporteuse spéciale que les entreprises et les gouvernements ne les consultent pas correctement et que leur droit de donner ou de refuser leur consentement libre, préalable et éclairé pour des activités ayant des impacts négatifs sur leur vie ou leur territoire est manipulé ou ignoré. De plus, les défenseurs des droits de l’homme en milieu rural n’ont souvent pas accès à des systèmes bancaires fiables, à Internet ou à une assistance juridique, particulièrement en période d’urgence.
Elle a réitéré que les gouvernements emprisonnent fréquemment, de manière illégale et cruelle, les défenseurs des droits humains dans des prisons isolées afin de les séparer de leurs familles et de leur soutien juridique. Enfin, elle a expliqué que la barrière linguistique est un obstacle majeur pour les locuteurs de langues minoritaires lorsqu’ils cherchent du soutien ou tentent de présenter leur travail à un public plus large.
Le représentant de l’Algérie a pris la parole pour apporter des clarifications sur certains points mentionnés dans le rapport de la Rapporteuse spéciale. Il a expliqué que le rapport indique qu’il n’existe pas de cadre de protection pour les défenseurs des droits de l’homme en Algérie, mais il a précisé que la Constitution de 2021, en particulier les articles 52 et 53, garantit un environnement propice aux activités des défenseurs des droits de l’homme, conforme aux pratiques internationales.Il a également mentionné la création du Bureau du Médiateur en 2021, qui sert de canal de communication pour le grand public. Des mesures ont été mises en place pour recevoir des plaintes relatives à la corruption et plusieurs lignes directes ont été installées pour encourager les signalements. En conformité avec les articles 19 et 20 de la Constitution, la liberté d’association, la liberté d’expression en public, le droit de réunion pacifique et les droits syndicaux sont garantis.
En outre, un nouveau projet de loi concernant les droits syndicaux a été adopté, et un projet de loi introduisant l’idée d’une association communale est en cours de rédaction. Ces associations pourront recevoir des financements étrangers, sous réserve de respecter certaines normes de transparence et d’obtenir une autorisation préalable.
Le représentant a précisé que le gouvernement n’a pas enregistré de cas de journalistes ou d’autres professionnels des médias ayant été poursuivis en raison du contenu de leur travail. La loi sur l’information empêchera toute forme de violence ou d’insultes à l’encontre des journalistes dans l’exercice de leurs activités.
Concernant la lutte contre le terrorisme, il a indiqué qu’il n’existe pas de définition universelle des actes terroristes, ce qui est en ligne avec le travail du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Enfin, le représentant a réitéré que l’Algérie a pris note des conclusions du rapport et reste disposée à poursuivre le dialogue avec la Rapporteuse spéciale et les autres titulaires de mandats des procédures spéciales.
Le représentant du Brésil a réaffirmé que les défenseurs des droits de l’homme au Brésil travaillent dans des endroits où de graves violations des droits humains ont lieu et sont confrontés à des menaces constantes. Par conséquent, le gouvernement brésilien a mis en place une politique nationale visant à répondre de manière efficace aux risques auxquels font face les défenseurs des droits humains depuis janvier 2023. Le président Lula a signé un décret qui a mis à jour le programme de protection des défenseurs des droits humains, des professionnels des médias et des environnementalistes. Ce décret a restauré la participation de la société civile au Conseil délibératif fédéral.
En décembre 2024, une proposition pour une politique nationale de protection des défenseurs des droits de l’homme a été soumise, élaborée par le groupe de travail technique Salish Pimenta. Cette proposition inclut le renforcement des institutions responsables de la sécurité des défenseurs, une protection de base qui soutient les réseaux communautaires et les organisations de la société civile, ainsi que des actions visant à garantir l’accès aux droits et à lutter contre l’impunité.
Il a confirmé que l’impunité demeure un problème majeur. En conséquence, le plan national inclut des efforts pour renforcer le travail conjoint entre le système judiciaire, la sécurité publique et les réseaux de protection communautaire. La lutte contre la déforestation illégale, l’exploitation minière sur des terres protégées et l’occupation illégale des terres reste une priorité du Brésil, ainsi que la lutte contre la violence institutionnelle et la criminalisation des militants des droits humains.
Pour garantir une protection plus large et plus efficace des défenseurs des droits humains, des efforts sont déployés pour étendre les programmes de protection, renforcer les mesures de sécurité collectives, établir un système de collecte de données et lancer des campagnes de sensibilisation. Il a souligné que ces politiques doivent prendre en compte l’intersectionnalité, en reconnaissant que la violence contre les défenseurs des droits de l’homme n’est pas un événement isolé, mais fait partie d’un cadre plus large d’inégalités systémiques. Des facteurs tels que le genre, la race, l’origine ethnique, la classe sociale, l’orientation sexuelle et l’identité de genre influencent de manière significative le niveau de vulnérabilité. Par conséquent, les stratégies de protection doivent être adaptées pour relever ces défis afin d’être réellement efficaces.
Dans ses messages présidentiels envoyés au Congrès national en 2024 et 2025, le président Lula a mis en évidence et réaffirmé son engagement en faveur de la politique de protection et a souligné l’importance du travail effectué par le groupe de travail.
Pays participants
La représentante de la Finlande, au nom des États baltes du Nord, a réaffirmé que les défenseurs des droits de l’homme dans des zones reculées ou isolées font face à des défis supplémentaires, tels que l’accès limité à l’assistance juridique, technologique et à d’autres formes de soutien. Elle a souligné que les défenseurs des droits des peuples autochtones ou de l’environnement sont rarement en mesure de donner leur consentement libre, préalable et éclairé pour des projets commerciaux potentiellement nuisibles.
Elle a ensuite posé la question suivante à la Rapporteuse spéciale : Que peuvent faire les États membres et les Nations Unies pour mieux identifier et atteindre les défenseurs des droits de l’homme dans les zones de conflit ?
Le représentant de l’Union européenne a fermement condamné tous les actes d’intimidation, de menaces et de répression transnationale de la violence contre tous les défenseurs des droits de l’homme, qu’ils se produisent en ligne ou hors ligne, où qu’ils se trouvent. Conformément au plan d’action sur les droits de l’homme et la démocratie, l’UE s’engage avec le secteur privé pour soutenir et promouvoir les droits de l’homme, la conduite responsable des affaires, la responsabilité sociale des entreprises, la diligence raisonnable, et l’accès aux recours, y compris pour les défenseurs des droits de l’homme.
Les lignes directrices de l’UE sur les défenseurs des droits de l’homme encouragent également les ambassades de l’UE dans le monde à protéger les défenseurs des droits humains de manière proactive, y compris en visitant les zones où ils travaillent.
Il a ensuite posé la question à la Rapporteuse spéciale : Comment mieux soutenir les défenseurs des droits de l’homme dans les zones isolées, y compris ceux qui opèrent dans des zones de conflit et sont détenus dans des prisons reculées ?
Le représentant de la Pologne, au nom des pays du Triangle de Lublin (Lituanie, Ukraine et Pologne), a reconnu le rôle essentiel que jouent les défenseurs des droits de l’homme dans la protection des droits humains, dans un contexte de plus en plus difficile. Il a fait référence au rapport dans lequel la situation des défenseurs dans des contextes de conflit, post-conflit et de crise, y compris ceux qui sauvent des civils des communautés sous le feu en Ukraine, a été mentionnée.
Il a posé la question suivante à la Rapporteuse spéciale : Quels sont les besoins les plus urgents de ce groupe de défenseurs, et quelles mesures supplémentaires devraient être prises pour les soutenir plus efficacement ?
La représentante de la République tchèque s’est alignée sur la déclaration de l’Union européenne. La République tchèque soutient la liberté des médias et continue de soutenir directement un certain nombre de médias indépendants, y compris des médias régionaux. Cela se fait en particulier par le biais du programme de promotion transitoire, qui fournit la protection nécessaire et un soutien pratique tel que la facilitation des visas, les abris et les relocalisations.
Elle a appelé à la libération de tous les défenseurs des droits de l’homme emprisonnés et a spécifiquement mis en lumière le cas d’un journaliste géorgien arrêté, fondateur d’un journal local. Elle a ensuite posé la question suivante à la Rapporteuse spéciale : Comment peut-on s’assurer que les récentes réductions de l’aide internationale ne nuisent pas de manière disproportionnée aux défenseurs des droits de l’homme dans les zones isolées ?
Le représentant du Mexique a salué les recommandations de la Rapporteuse spéciale, en particulier l’approche différenciée qui tient compte des conditions particulières des zones rurales et de la vulnérabilité de certains groupes de personnes, tels que les femmes, les jeunes femmes, les filles et les peuples autochtones. Le Mexique a réaffirmé son engagement en faveur de la protection des défenseurs des droits de l’homme en 2020 en ratifiant l’accord, ce qui a marqué la première convention à inclure des dispositions spécifiques pour les défenseurs des droits humains environnementaux.
Le Mexique continuera de renforcer les mécanismes de protection pour les défenseurs des droits humains et les journalistes, dans le but de garantir l’exercice de la liberté d’expression, le droit d’accès à l’information, et de s’assurer que les défenseurs puissent exercer leur travail sans être victimes de violence.
Le représentant de l’Équateur a exprimé son accord avec la conclusion de la Rapporteuse spéciale sur la relation entre la localisation des défenseurs des droits de l’homme et les risques et défis particuliers auxquels ils sont confrontés. L’Équateur s’est aligné sur la recommandation selon laquelle tous les États devraient protéger le travail des défenseurs des droits humains, et, à cette fin, le pays a adopté un ensemble de mesures complètes pour garantir leur protection.
Il a mis en évidence la création du bureau interinstitutionnel pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et de la nature, co-dirigé par l’ombudsman et le Ministère des Femmes et des Droits de l’Homme. Le représentant a ajouté que l’Équateur était le premier pays à soumettre son plan de mise en œuvre sous l’accord et a co-dirigé la négociation du premier plan d’action sur les défenseurs des droits de l’homme environnementaux en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Il a conclu son intervention en soulignant que l’Équateur développe des mécanismes supplémentaires d’évaluation des risques et de diligence raisonnable dans les secteurs stratégiques, tout en renforçant la capacité organisationnelle et communautaire en matière de droits de l’homme.
Le représentant de la Colombie a souligné la nécessité d’adapter les focalisations de protection aux réalités locales, en particulier pour les droits des peuples autochtones, ceux travaillant dans des contextes isolés et ceux exposés à une grande marginalisation. La Colombie dispose d’un programme de sauvegarde complet pour les femmes leaders et défenseures des droits de l’homme, afin de garantir leur sécurité.
Le représentant a reconnu que des défis demeurent, en particulier dans les zones rurales et reculées, qui sont affectées par le conflit armé et par les irrégularités qui persistent dans un conflit alimenté par des économies illicites. Il s’est engagé à suivre de près les cas d’Abelardo Lis et Alirio Paredomo mentionnés dans le rapport, afin d’éclaircir les faits à leur sujet.
Le représentant de la Fédération de Russie a qualifié le rapport de controversé. Il a exprimé son désaccord avec l’hiérarchisation artificielle des personnes protégeant les droits humains et l’identification parmi elles de groupes spécifiques considérés comme vulnérables. Selon lui, cette approche est discriminatoire et ne correspond pas au principe d’équité.
Il a souligné les tentatives continues de la Rapporteuse spéciale d’améliorer le volet suivi de son travail en accordant davantage d’attention à l’examen des communications privées sur les violations, ce qui, selon lui, constitue une violation des droits des individus exerçant des activités de défense des droits humains. Il a rappelé à la Rapporteuse spéciale que le but principal de son mandat est de fournir une assistance aux États, d’identifier les problèmes et d’établir un dialogue constructif avec eux, et non de reprocher ou d’attribuer des blâmes.Le représentant a conclu en lançant un appel à aborder les procédures spéciales de manière indépendante, impartiale, de bonne foi, objective et dépourvue de toute politisation.
Le représentant de la Chine a exprimé sa préoccupation concernant les références dans le rapport aux soi-disant défenseurs des droits de l’homme en Chine. Il a affirmé que la Chine est un pays de l’État de droit où tout le monde est égal devant la loi, et qu’aucun statut professionnel n’exonère quelqu’un des sanctions légales. Selon lui, les soi-disant défenseurs des droits humains mentionnés dans le rapport ont tous été condamnés légalement, suivant un processus dû, avec des preuves claires, des accusations précises et des sentences appropriées. Il a ajouté que leurs droits légitimes pendant leur emprisonnement ont été pleinement garantis. Selon lui, la punition des délits et crimes conformément à la loi n’est fondamentalement pas un problème de droits humains.
Il a ajouté que certains pays et forces politiques ont faussement qualifié des criminels de défenseurs des droits humains et ont toléré leurs activités perturbatrices dans d’autres pays, ce qui mérite une condamnation internationale.
Le représentant a conclu en affirmant que la Chine est prête à engager un dialogue constructif avec la Rapporteuse spéciale, basé sur le respect mutuel, et que la Rapporteuse spéciale remplira ses fonctions de manière objective, en prenant dûment en compte les matériaux de réponse fournis par la Chine et en ne se laissant pas tromper par des informations erronées.
La Rapporteuse spéciale a pris la parole pour commenter brièvement les nombreuses questions et interventions. Elle a exprimé sa frustration face à la déconnexion entre ce qui est dit en matière de protection des défenseurs des droits humains et la réalité sur le terrain. Elle a souligné sa déception que, malgré les politiques gouvernementales affirmant protéger les défenseurs, la situation sur le terrain montre tout autre chose.
Elle a salué le courage des représentants de l’Algérie et du Brésil, qui l’ont invitée malgré leurs propres défis en matière de droits humains. Elle a également mentionné avoir reçu 18 refus ou aucune réponse pour ses demandes de visites dans certains pays, dont 10 pays affirment avoir des invitations permanentes.
Un développement positif qu’elle a partagé est la libération de Mohammed Al-Qatani en Arabie saoudite, depuis la rédaction du rapport, bien qu’il soit toujours soumis à une interdiction de voyage.
La Rapporteuse spéciale a ensuite abordé certaines des questions concernant la manière de mieux soutenir les défenseurs des droits humains dans des zones isolées et en conflit. Elle a appelé à plus d’assistance, y compris un soutien financier, des routes d’évacuation, et à offrir des visas pour les défenseurs des droits humains. Elle a particulièrement mis en lumière la violence à l’encontre des défenseurs dans des pays comme le Soudan, Gaza, l’Est du Congo et l’Ukraine, tout en soulignant l’importance de défendre ces défenseurs.
Elle a également critiqué certains pays pour détention de défenseurs des droits humains dans des zones reculées, permettant des représailles, et pour réduire les financements. Elle a spécifiquement mentionné le cas d’Abdul Rahim Al-Khadid, détenu en Bulgarie, en appelant à sa protection.
Enfin, elle a exprimé sa frustration vis-à-vis de la Russie et de la Chine, qui, selon elle, refusent d’engager un dialogue, tout en persécutant des défenseurs des droits humains et en se plaignant de son travail en tant que Rapporteuse spéciale.
Le représentant de Cuba a souligné l’engagement de son pays à protéger les défenseurs des droits humains, en citant la participation active de Cuba à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques visant à garantir les droits humains. Il a exprimé que certaines personnes qui se présentent comme des défenseurs des droits humains sont en réalité des mercenaires agissant au service de puissances étrangères. Selon le représentant, ces individus sont payés pour saper la souveraineté et promouvoir des changements de régime, attaquant l’ordre constitutionnel librement choisi par le peuple cubain.
Il a précisé que ce comportement est inacceptable à Cuba et dans tout État régi par l’État de droit.
De plus, le représentant a fait référence à de nouvelles preuves concernant des ressources financières considérables en provenance de l’agence américaine USAID, s’élevant à des centaines de millions de dollars, utilisées pour saper l’ordre constitutionnel de Cuba, ainsi que la stabilité d’autres pays, sous couvert de protéger les droits humains et de promouvoir la démocratie.
Le représentant de la Géorgie a décrit l’engagement continu de son pays dans les travaux du Comité des ONG des Nations Unies, soulignant que le travail du CNGO influence directement la participation des ONG dans le système des Nations Unies et la coopération entre l’ONU et la société civile. Elle a mis en avant l’importance de préserver le droit de réunion et de manifestation, en s’attendant à ce que les institutions concernées garantissent à la fois l’ordre public et le droit légal à de telles activités.
Cependant, la situation actuelle dans les régions occupées de la Géorgie, où la reconnaissance légale du contrôle russe a été confirmée par les décisions de la CEDH et de la CPI, limite gravement la capacité du gouvernement géorgien à exercer son autorité et à mettre en œuvre des politiques dans ces zones. Elle a conclu en soulignant que les individus dans ces régions continuent de faire face à des violations significatives et systématiques de leurs droits et libertés fondamentaux, notamment des restrictions sur la liberté de circulation imposées par les forces occupantes.
Le représentant de l’Afghanistan a mis en lumière les atrocités systématiques commises par les talibans, notamment à l’encontre des femmes, des filles et des groupes marginalisés. Les politiques répressives des talibans, notamment l’interdiction de l’éducation des filles et la persécution des défenseurs des droits des femmes, constituent une violation des obligations internationales en matière de droits humains.
Il a exprimé la nécessité de prêter une attention particulière aux défenseurs des droits des femmes et des jeunes, dont la résilience et le courage continuent d’inspirer malgré l’environnement oppressif auquel ils sont confrontés.
Il a demandé à la Rapporteure spéciale quelles mesures supplémentaires pourraient être mises en œuvre pour s’assurer que les avis des défenseurs des droits des enfants et des jeunes, en particulier ceux des régions isolées, soient véritablement pris en compte dans les processus internationaux de défense des droits humains et dans les forums de prise de décision.
Le représentant de la République bolivarienne du Venezuela a souligné que l’Article 132 de la constitution permet à toutes les personnes de participer à la vie politique, civile et communautaire du pays. Le nouveau plan gouvernemental, qui comprend sept transformations clés, met en avant l’engagement de l’État à affiner son modèle de coexistence citoyenne. Ce plan garantit la justice, protège les droits humains et soutient la paix sociale et territoriale, offrant ainsi un cadre idéal pour le travail des défenseurs des droits humains.
Il s’est opposé à ce que des personnes politiquement motivées, financées de l’étranger, utilisent la noble cause des droits humains pour mener des activités déstabilisatrices contre le gouvernement vénézuélien. Il a insisté sur le fait que le rôle des défenseurs des droits humains ne confère pas d’immunité face à la loi, en particulier lorsqu’il s’agit d’activités criminelles. Le représentant a réitéré la nécessité pour les titulaires de mandats, tels que ceux impliqués dans des procédures spéciales, de respecter strictement le code de conduite établi et de mener leur travail sur la base d’informations fiables, factuelles et d’objectifs clairs.
La représentante du Canada a réitéré que les risques sont exacerbés pour ceux qui subissent plusieurs formes de discrimination croisées. Elle a souligné que la criminalisation des défenseurs des droits humains et l’abus des lois sur la sécurité nationale sont inacceptables. Les restrictions sur l’accès à Internet et le flux de financement international vers les organisations locales de défense des droits humains peuvent également accroître la vulnérabilité dans ces contextes. Le Canada a salué la mise en place de réseaux de soutien locaux, le renforcement des canaux de communication numériques, la fourniture de premiers secours, et la mise en œuvre de voies de soutien juridique. La représentante a insisté sur le fait que la protection des droits humains inclut l’adoption d’approches différenciées selon le genre, la recherche du consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones, ainsi que l’acceptation de la critique indépendante et constructive.
Organisations Non Gouvernementales
Les représentants de diverses organisations non gouvernementales (ONG) ont exprimé leurs préoccupations concernant les défis rencontrés par les défenseurs des droits humains (HRD) à l’échelle mondiale, en particulier dans les zones de conflit, les régions isolées et sous des régimes répressifs.
En particulier, la sécurité des HRD à Gaza a suscité une grave inquiétude, tout comme les violations des droits des HRD en Éthiopie, incluant l’intimidation, les enlèvements et la suspension des organisations de défense des droits humains, ainsi que la violence subie par les HRD en Colombie, notamment dans les zones rurales et isolées. Ils ont rapporté un nombre élevé d’assassinats de HRD en Colombie et ont souligné la nécessité d’un soutien et d’une action internationale.
De plus, les difficultés rencontrées par les HRD au Brésil ont été abordées, en particulier pour ceux faisant face à des formes croisées de discrimination, qu’il s’agisse de leur identité de genre, de leur race, de leur ethnie, de leur orientation sexuelle ou de leur territoire. La situation se détériorant pour les HRD en Géorgie a également été mentionnée, en particulier la répression des manifestants pacifiques et des HRD par le gouvernement, ainsi que les législations restrictives, telles que la loi sur l’influence étrangère qui stigmatise et criminalise désormais les activités de la société civile. Le Brésil a été incité à établir des mécanismes efficaces de supervision policière pour traiter la violence et les détentions arbitraires. Il a été souligné qu’il s’agit d’une lutte mondiale pour les HRD. Une ONG a averti de la répression croissante en Argentine, où les défenseurs des droits humains sont persécutés, et a exhorté le gouvernement à aligner ses actions sur les normes internationales des droits humains. Il a été expliqué que le système international des droits humains est affaibli par les doubles standards des États, les dirigeants autoritaires et les entreprises irresponsables. Ils ont appelé à un soutien politique et financier accru pour les HRD. Certains représentants ont partagé leurs récits personnels de violence, illustrant la violence contre les peuples autochtones au Brésil et les abus des réfugiés sahraouis en Algérie.
Chaque représentant a souligné l’urgence d’une attention, d’une protection et d’une action internationales pour garantir la sécurité et la liberté des défenseurs des droits humains à travers le monde.
Remarques de conclusion
La Rapporteuse spéciale a commencé par s’adresser à la Chine, s’excusant du fait qu’ils répondent à ses questions, mais que ces réponses manquent de signification, notamment en ce qui concerne les Tibétains. Elle a ensuite abordé un représentant de la Russie, demandant des informations sur le sort de Victoria Rochina et la libération médicale de Taufik Abdulhaizeb, un défenseur des droits humains tatare de Crimée. La Rapporteuse spéciale a remercié les pays qui l’avaient invitée, mais a également critiqué l’Afrique du Sud pour ne pas s’engager. Elle a salué le soutien du Canada aux défenseurs des droits humains à l’étranger grâce à son programme de visas, mais a appelé à une plus grande responsabilité des entreprises canadiennes impliquées dans l’exploitation minière et leur impact sur les défenseurs des droits humains.
La Rapporteuse spéciale a également exprimé des inquiétudes concernant l’atténuation de la diligence raisonnable obligatoire en matière de droits humains et d’environnement par l’UE. En ce qui concerne la Géorgie, la conférencière a exprimé son désaccord avec la déclaration de leur représentant, mettant en lumière la situation qui s’est aggravée pour les défenseurs des droits humains depuis sa visite dans le pays : législation restrictive, enquêtes sans fondement, diffamation par des politiciens et attaques physiques contre les défenseurs des droits humains. Elle a exprimé son désir de soutenir les femmes défenseures des droits humains d’Afghanistan, mais aucun pays ne lui a accordé de visas pour elles. Elle a reconnu le Mexique et l’Équateur pour avoir ratifié l’Accord d’Escazú et a exhorté d’autres États à emboîter le pas. Pour le Venezuela et Cuba, la Rapporteuse spéciale a fermement rejeté les accusations selon lesquelles elle ne respecterait pas le code de conduite, soulignant qu’elle connaît la différence entre un défenseur des droits humains et un activiste politique/agent étranger/terroriste. La Rapporteuse spéciale a également souligné l’importance de soutenir les droits des paysans et a rappelé aux États leur responsabilité de protéger les droits humains – et non celle de la Rapporteuse spéciale, des autres procédures spéciales et de leur personnel, ni du personnel de l’ONU. Elle a insisté sur le fait que bien qu’il y ait eu certains progrès, il reste encore beaucoup à accomplir : les meurtres, les disparitions, les attaques, la discrimination, l’emprisonnement à long terme, et l’environnement hostile auquel les États soumettent les défenseurs des droits humains. Elle a mis en lumière les efforts du Brésil et de la Colombie pour protéger les défenseurs des droits humains par des visites et des mécanismes de protection, et en reconnaissant leur légitimité à travers des lois, des pratiques et des politiques. Elle a conclu en exhortant tous les États à prendre leurs responsabilités. Elle a dit aux représentants qu’ils ont une voix, une influence, et qu’ils sont capables d’agir.
Position de Geneva International Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice (GICJ) soutient le rapport de la Rapporteuse spéciale, en particulier l’accent mis sur la mise en place de mécanismes de protection et l’extension des ressources de sécurité numérique. Le GICJ souhaite rappeler que le travail des défenseurs des droits humains renforce la démocratie et que leur travail et leur vie doivent être protégés.
Le GICJ plaide pour que les États protègent de manière proactive les défenseurs des droits humains dans les zones isolées, éloignées ou rurales et qu’ils élaborent des politiques répondant aux besoins divers des groupes marginalisés. Le GICJ encourage également les entreprises à prendre leurs responsabilités et à impliquer les organisations de la société civile pour protéger et inclure les défenseurs des droits humains dans les zones rurales.